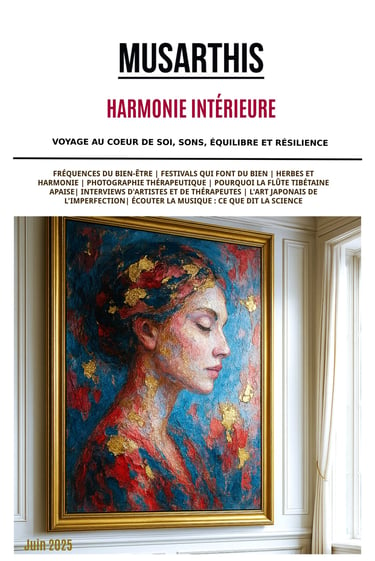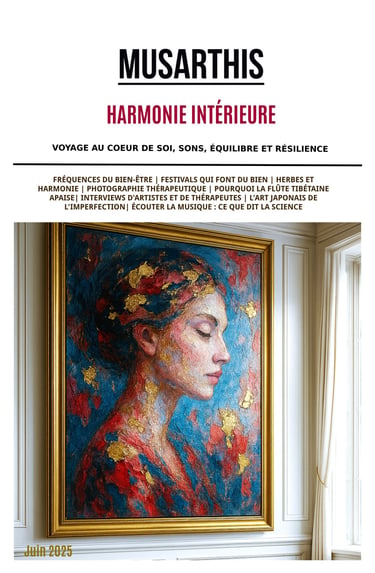Les arts et la créativité pour l'épanouissement

LE GOÛT DES COULEURS
Cet article propose une méditation sensorielle et poétique sur la manière dont les couleurs influencent notre expérience du goût. Entre science, mémoire et émotions, Marlena Des explore comment chaque teinte, du rouge éclatant au bleu mystérieux, prépare nos sens et réveille nos souvenirs. Une invitation à redécouvrir la nourriture comme un art, où voir, c’est déjà goûter.
Marlena Des
6/19/20255 min read


Méditation sensorielle d’été, nourrie par la science, la mémoire et le monde
Il est des nourritures que l’on porte à la bouche sans urgence.
Avant le goût, il y a la lumière.
Avant la mastication, il y a la teinte, la forme, l’ombre portée sur l’assiette.
Ce que nous appelons « manger » commence bien avant la première bouchée :
il commence par le regard, par l’intuition, par une sensation chromatique.
Manger est un acte culturel, émotionnel, parfois spirituel.
En été, tout s’intensifie : les fruits se colorent comme s’ils avaient attendu toute l’année pour s’exprimer.
Ils deviennent silences juteux, nuances comestibles, petites épiphanies naturelles.
Ils ne remplissent pas : ils révèlent.
Ce texte ne décrit pas des recettes.
Il explore une idée simple mais féconde : la couleur agit sur le goût.
Elle le prépare, le module, parfois le transforme.
Et les recherches scientifiques ne contredisent pas cette intuition.
Elles la prolongent, avec leurs tableaux et leurs tests sensoriels.
Mais tout commence dans la pulpe d’un fruit.
Rouge — intensité, désir, appétence
Fraises juteuses, tomates anciennes, cerises brillantes…
Le rouge attire, stimule, pulse.
Johnson et Clydesdale (1982) ont montré qu’un liquide rouge est perçu comme plus sucré qu’un incolore au même taux de sucre.
Spence et Levitan (2010) confirment : le rouge intensifie les attentes sensorielles.
Mais ces perceptions varient : en Afrique de l’Ouest, le rouge n’est pas toujours associé au plaisir mais parfois à la vigilance (piments, interdits), alors qu’au Japon, il est proche de la célébration.
Le rouge est une promesse : mais sa promesse change de langue.
Rose — douceur sensorielle et appel discret
Certaines fleurs, certains fruits, certaines lumières révèlent un rose qui ne s’impose pas mais reste.
Maga (1974) et Zellner & Durlach (2002) ont montré que cette teinte est associée à la douceur et à une impression de légèreté.
En synesthésie, certaines personnes goûtent le rose comme on goûterait un bonbon à la rose, sans sucre, juste parfum.
Le rose devient sensation silencieuse : comme un souvenir flou mais chaud, une caresse dans le palais.
C’est l’intime visible.
Jaune et orangé — lumière offerte, chaleur paisible
Pêches, abricots, melon, courge d’été…
Ces teintes solaires rassurent.
Piqueras-Fiszman et Spence (2011) ont observé que les couleurs chaudes augmentent les attentes sucrées et joyeuses.
En Chine traditionnelle, le jaune est couleur impériale, solaire, noble ; en Afrique du Nord, il évoque parfois la maladie ou l’excès de bile.
La couleur ne parle jamais toute seule.
Elle parle avec les codes que nous avons reçus.
Vert — fraîcheur, clarté, vitalité
Feuilles, herbes, concombres, fenouil.
Le vert n’est pas démonstratif : il clarifie. Il trace des lignes nettes.
Wang & Spence (2019) indiquent que le vert évoque pureté, tonicité, netteté.
En synesthésie, le vert peut être « amer doux », presque mentholé.
Mais dans certaines zones rurales d’Asie du Sud-Est, le vert profond est lié au poison (plantes médicinales toxiques ou puissantes), alors que dans l’imaginaire occidental, il est associé à la santé.
Manger vert n’a pas toujours la même saveur.
Bleu — rareté, silence et étrangeté comestible
Le bleu est l’une des couleurs les plus rares dans le monde végétal.
Myrtilles, bourraches, vitelottes… Il est discret, presque secret.
Zampini et Spence (2012) ont montré que le bleu, bien qu’associé au sucré, peut aussi réduire l’appétence, car il surprend.
Il est couleur de distance, de méditation.
En synesthésie, il est souvent perçu comme un goût doux-froid, comme la crème fraîche ou l’eucalyptus, mais sans parfum.
Dans certaines cultures africaines, le bleu profond est la couleur des ancêtres, du ciel traversé, de la sagesse : le manger devient presque sacré.
Le bleu n’excite pas le palais : il l’interroge.
Violet — lenteur, densité, intériorité
Mûres, figues, aubergines…
Le violet murmure quelque chose d’ancien.
Zampini & Spence (2012) soulignent que les couleurs sombres comme le violet évoquent l’intensité.
Le violet est presque sonore, presque baroque.
Il évoque les nourritures du soir, les silences profonds, les voix basses.
Dans les traditions du sud de l’Inde, il est lié aux mystères, à la non-dualité, à la retraite intérieure.
Blancs, beiges, translucides — silence et subtilité
Poire, raisin blanc, lait d’amande…
Ces teintes calmes sont des espaces entre deux sensations.
Wichmann et al. (2002) ont montré que les couleurs désaturées induisent une perception plus douce et lente.
Mais ici encore, tout dépend du cadre : en Occident, le blanc est festif, neutre, voire joyeux.
En Asie orientale, il est couleur du deuil, du retour à l’origine, parfois même de l’austérité.
Ce que l’un perçoit comme pur, l’autre peut lire comme grave.
Et c’est là toute la richesse.
Manger la couleur
Manger est un dialogue : entre regard, texture, souvenir, attente.
La couleur prépare le cerveau au goût (Spence, 2015).
Elle lance un récit sensoriel bien avant la première bouchée.
Et pour certaines personnes synesthètes, elle est le goût : chaque teinte appelle une saveur, chaque fruit active une couleur intérieure.
Parfois, un simple fruit suffit à faire advenir l’instant.
Et parfois, dans l’ombre fraîche d’un jour qui penche,
le goût d’un abricot parfaitement mûr fait remonter une scène oubliée :
une voix, un rire, un été passé sous une tente, ou un prénom qu’on n’a plus prononcé.
La couleur a alors accompli plus qu’un rôle : elle a réveillé une mémoire.
Une mémoire gustative, tactile, émotionnelle.
Et c’est peut-être là, dans cette fusion entre le visible et le vécu,
que le goût devient art —
et que manger, parfois, devient un acte de reconnaissance intérieure.
Références bibliographiques
Johnson, J. L., & Clydesdale, F. M. (1982). Perceived sweetness and redness in colored sucrose solutions. Journal of Food Science, 47(3), 747–752.
Maga, J. A. (1974). Influence of color on taste thresholds. Chemical Senses & Flavor, 1(1), 115–119.
Zellner, D. A., & Durlach, P. (2002). What is refreshing? Appetite, 39(2), 185–186.
Piqueras-Fiszman, B., & Spence, C. (2011). Crossmodal associations between color and taste/flavor. Chemosensory Perception, 4(3), 174–185.
Wang, Q. J., & Spence, C. (2019). “What’s your taste in colors?” Food Quality and Preference, 71, 223–231.
Zampini, M., & Spence, C. (2012). Assessing the role of sound in the perception of food and drink. Flavour, 1(1), 1–9.
Wichmann, F. A., Sharpe, L. T., & Gegenfurtner, K. R. (2002). The contributions of color to recognition memory for natural scenes. Journal of Experimental Psychology, 28(3), 509.
Spence, C. (2015). Multisensory flavor perception. Cell, 161(1), 24–35.
Spence, C., & Levitan, C. A. (2010). Crossmodal correspondences between vision and flavor. Crossmodal Space and Crossmodal Attention, 29, 143–167.
Ramachandran, V. S., & Hubbard, E. M. (2001). Synaesthesia—A Window Into Perception, Thought and Language. Journal of Consciousness Studies, 8(12), 3–34.
Cytowic, R. E. (2002). Synesthesia: A union of the senses. MIT Press.
Goûts en farandole,
la couleur rit sur la langue,
le citron s’élance,
l’été danse en transparence.